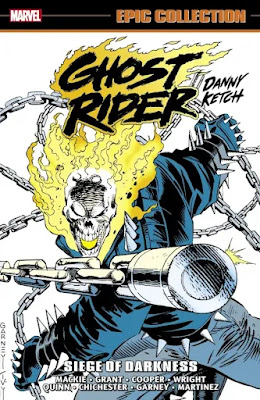Spoiler possible (au sujet de comment arrêter Galactus uniquement)
Avec The Fantastic Four : First Steps, Marvel Studios tente une nouvelle fois de réhabiliter ses pionniers mal-aimés du grand écran. Après une succession d'échecs plus ou moins retentissants en guise de fardeau, et un MCU en perte de vitesse (ne nous voilons pas la face), cette itération réalisée par Matt Shakman, sur fond de sixties réinventées et de crises existentielles, se veut à la fois reboot, manifeste esthétique et film à taille humaine. Mission réussie ? Pas tout à fait. Enfin, ça dépend de ce qui vous pousse à le voir, en fait. Sur le papier, l’idée est séduisante : abandonner le poids de la super continuité pour livrer un film autoportant, centré sur la dynamique familiale des Quatre Fantastiques. Et de fait, le film commence fort. Reed, Sue, Johnny et Ben ont déjà leurs pouvoirs, leur notoriété et leur QG sur Terre-828, une réalité alternative où l’architecture rétrofuturiste, les voitures volantes et les montres parlantes ont remplacé les références aux Avengers. Plus besoin de se farcir quinze films et six séries pour comprendre qui est qui : ici, chacun arrive en scène avec son rôle et sa charge symbolique. Et au diable la sempiternelle origin story, alors traitée à la manière d'un documentaire, film dans le film. Mais derrière cette liberté apparente se cache un paradoxe. En démarrant dans le vif du sujet, Shakman gagne du temps, mais perd en intensité. L’attachement aux personnages, censé être immédiat, tarde à se produire. L’intelligence scénaristique, qui condense les enjeux familiaux et cosmiques dans une intrigue resserrée, ne suffit pas toujours à pallier un déficit d’émotion qui s'avère assez criant, à plusieurs reprises. L’atout majeur du film reste son duo central : Pedro Pascal, en Reed Richards, incarne assez bien l’archétype du savant brillant rongé par ses doutes, tandis que Vanessa Kirby électrise l’écran en Sue Storm. C’est elle, véritable colonne vertébrale du récit, qui mène l’action, résout les conflits, et donne au groupe une humanité crédible. La scène de dialogue avec l’Homme-Taupe – réjouissante apparition burlesque de Paul Walter Hauser – résume à elle seule l’équilibre étrange du film : entre sincérité et second degré, absurdité et drame. L’intrigue, quant à elle, repose sur un dilemme audacieux : Galactus accepte de ne pas détruire la Terre, il réclame en retour… le fœtus de Sue. Un twist inattendu, presque dérangeant, qui aurait pu nourrir un drame dense sur la parentalité, le sacrifice et l’autonomie. Malheureusement, l’idée, puissante sur le papier, se dilue dans un final trop expéditif. La confrontation avec le Dévoreur de Mondes – massif mais fade – manque d’ampleur, et le prix à payer, pourtant déchirant, est traité sans réelle gravité.
Le reste du casting tient la route, sans vraiment sortir du lot. Johnny Storm amuse sans éclat, malgré une relation intrigante avec la Silver Surfer (Julia Garner, magnétique mais sous-exploitée). Ben Grimm, quant à lui, est relégué à l’arrière-plan, victime d’un montage visiblement amputé. Une bluette vaguement esquissée avec une institutrice (Rachel Rozman, rien à voir avec Alicia Masters) n’y change rien : La Chose reste ici un second couteau émouvant mais sacrifié. Visuellement, First Steps est un festin. Couleurs vives, décors stylisés, musique de Michael Giacchino aux accents sixties : l’univers alternatif séduit l’œil, même si l’ensemble finit par ressembler à une belle maquette sans âme. Le film hésite sans cesse entre plusieurs tons : space opera, fable familiale, parodie méta, épopée mélancolique… et finit par n’être vraiment aucun des quatre. C'est bubble-gum à souhait, joli, mais ça ne sert aucun ressort scénaristique (et ça permet de botter en touche pour ce qui est de raccrocher les wagons. Pour l'arrivée des F4 aux côtés des Avengers, il faudra patienter). En comparaison directe avec le Superman de James Gunn, sorti la semaine dernière, la défaite est patente. Là où Gunn parvient à infuser une modernité émotionnelle et sociétale dans un mythe archétypal, First Steps reste prisonnier d’une prudence stérile. On devine l’envie de bien faire, de surprendre, de réinventer. Mais tout semble bridé : les pouvoirs sont utilisés à minima (Mister Fantastic n'est pas si fantastique), l’humour est timide, les enjeux sont désamorcés. Hors de question de déplaire à une partie du public (sauf les défenseurs hardcore de Norrin Rad, bien entendu), là où Superman assume pleinement une vision anti trumpiste du monde et de l'Amérique. L'absence de prise de risque qui nous irrite tant, c'est par exemple lorsqu'il est question d'aborder de front la réaction de Reed Richards, lorsqu'il réalise que le sacrifice de son fils pourrait être le seul moyen de stopper Galactus. Le film aurait vraiment pris de l'ampleur s'il avait tenté d'insinuer sérieusement le doute, mis la petite famille au pied du mur ; au lieu de cela, tous ces choix atroces sont rapidement évacués (si j'y pense ? Non, Sue, je blaguais) tout comme d'ailleurs les réactions de la foule. Imaginez un peu une planète entière sur le point d'être dévorée, mais qui aurait encore une chance de s'en sortir, si pour cela on sacrifiait à sa cause un nouveau-né… Vous pouvez parier que la population se déchaînerait contre les Fantastiques et ferait tout ce qui lui est possible pour s'emparer du bambin. Tout au plus, on se contente de quelques huées et de journalistes qui boudent. C'est assez hautement improbable, tout comme il est dommage que la figure christique du Silver Surfer soit galvaudée et résumée, à un certain point, en une autre histoire de maternité. Au peuple irréductible de "le Surfer est un homme", objectons qu' il a en partie raison et en partie tort, puisque nous sommes de toute manière dans un univers parallèle non canonique, ce qui exclut pas à l'avenir de faire intervenir un Norrin masculin traditionnel, lorsque le travail de couture aura été réalisé, c'est-à-dire lorsque les Fantastiques auront rejoint la timeline classique du MCU. Ce sera pour très bientôt comme on peut s'en rendre compte dans une des deux scènes bonus à la fin du film. La seconde est totalement inutile et si vous partez avant la fin du générique, sachez que vous ne perdrez absolument rien pour la compréhension de ce qui suivra. Alors, échec ou (re)fondation prometteuse ? Disons que The Fantastic Four: First Steps est un film qui veut tout reprendre à zéro… sans oser prendre de vrais risques. Il avance prudemment là où il pouvait (dé)foncer. La famille est là, le terrain est balisé, nous voici rassurés. Pour le grand frisson, on verra plus tard.
UniversComics, votre communauté comics de référence :








.jpg)